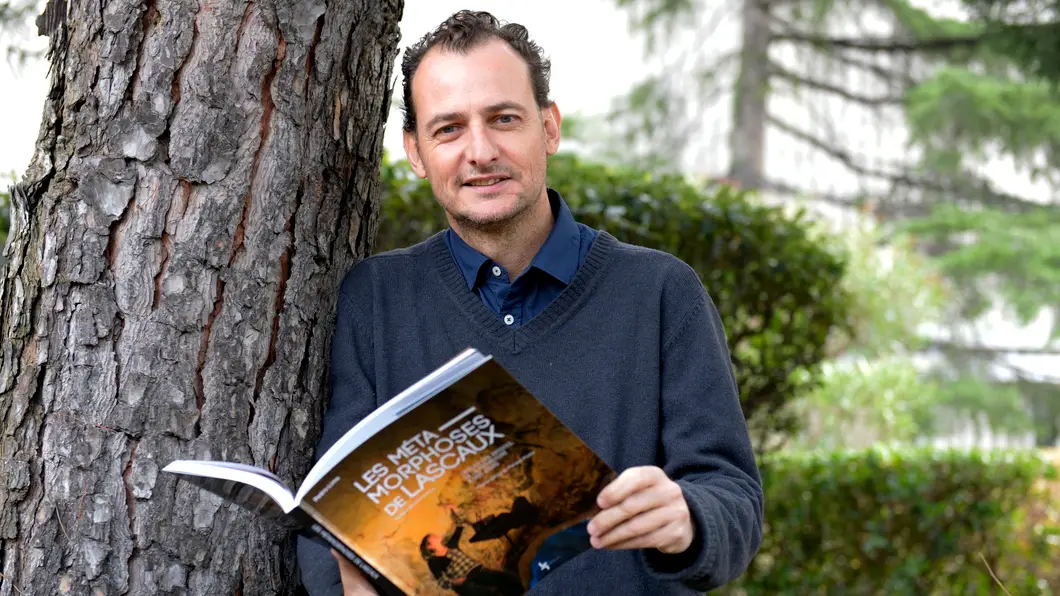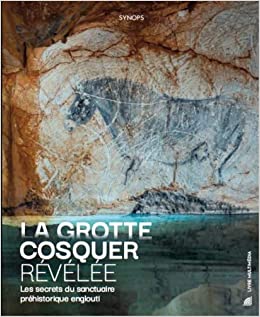13h40 : 3ᵉ conférence : La médiation en gestion de conflit en environnement – Gaëlle Le Bloa
Gaëlle Le Bloa présente la médiation comme moyen de résolution des conflits environnementaux. Elle met en avant l’utilisation d’un outil pertinent pour le dialogue : la communication non violente et appuie sur l’importance de la place de l’individu dans le dialogue qui elle doit être centrale.
La communication non violente se base sur le principe d’une communication traditionnelle avec une invitation à déployer son être (à travers 4 piliers : observation, sentiment, besoin et demande).
On retient la nécessité pour le médiateur de créer un cadre bienséant, comprenant sécurité, respect et écoute pour le déploiement du dialogue. C’est au médiateur d’organiser le déroulé de la réunion, et de favoriser la création du groupe. L’interconnaissance est essentielle, elle se crée autour d’espace favorisant le partage de regards et garantissant l’expression de tous. Des outils brise-glaces ou faisant appel au sensitif et ludique (ex : le photolangage) existent pour favoriser la participation collective. L’intelligence collective réside dans une intervention de chacun placé au même niveau et placé sous un respect des idées.
13h50 : 4ᵉ conférence : Comment aborder la complexité de la transition écologique ? – Thierry Tatoni
Thierry Tatoni nous explique comment affronter la complexité de la transition écologique en cours, qui peut être perçue comme un idéal.
Pour cela, son équipe de travail met en place une structure spécifiquement dédiée à l’étude de la transition écologique rassemblant des disciplines allant de la philosophie jusqu’à la physique des matériaux.
Il souligne l’importance de la production de connaissances. Néanmoins, la connaissance est loin d’être le seul levier à actionner pour enclencher la transition écologique. Premièrement, ce levier n’est pas bon s’il reste disciplinaire. Il faut aussi envisager une transdisciplinarité entre les sciences biophysiques et les sciences humaines et sociales. Deuxièmement, il faut s’inscrire dans une logique de partage des connaissances. L’objectif est aussi d’avoir une vision la plus globale possible : la vision intégrative a du potentiel pour fournir des éléments importants. Il est intéressant d’envisager une science moins égocentrée, plus ouverte d’esprit.
14h05 : TABLE RONDE : Les grandes idées de la table ronde, avec Jacques Daligaux, Cécilia Claeys, Gaëlle Le Bloa et Thierry Tatoni.
L’éducation à l’environnement. Si on ne s’attaque pas aux structures de la société on ne peut espérer un changement. L’éducation à l’environnement doit aussi être accompagnée d’une éducation au dialogue.
La médiation scientifique. Il est hautement nécessaire de vulgariser la connaissance, la rendre compréhensible par tous.
La communication non violente. Elle doit toujours intervenir en amont. Elle permet de se mettre d’accord sans que ce ne soit un tiers qui définisse la personne responsable. C’est un dialogue entre deux partis qui s’entendent sur un accord dans un cadre de respect et d’écoute.
La neutralité du médiateur. Le médiateur est là pour aider au rapprochement entre les partis. Il ne doit pas sortir de sa neutralité mais doit faire en sorte que les personnes qui sont autour de la table soit les « bonnes » personnes pour traiter du sujet : pertinentes et complémentaires. Ce sont ces personnes qui vont incarner et défendre la gestion du bien commun.
Les limites de la médiation. Dans des conflits très difficiles, qui engagent la santé des individus ou la destruction définitive de biens, et dans lesquels les points de vue ne sont pas conciliables, il est compliqué d’envisager une résolution malgré l’utilisation de la médiation. Le conflit nous place dans une situation de combat, chacun a des armes quelle que soit leur représentation. La notion de concertation en médiation n’a pas de place attribuée. Elle n’arrive pas à se positionner en tant qu’arme.
Cependant, son utilisation est toujours bénéfique car elle mobilise les ressentis propres à chacun ce qui est toujours une réussite dans un conflit. L’abandon d’un parti peut être considéré comme une réussite même si ce n’est pas une résolution parfaite car on considère que la situation a été débloquée.
L’anticipation de conflit. Il faut directement aller voir ce qui se passe sur le terrain, valable pour toutes les entités. Et lorsqu’on est scientifiques, cela aide à être perçu différemment.
L’intelligence collective. Elle est essentielle, “même si elle peut paraître insupportable pour un chercheur, qui par principe se veut intelligent tout seul”. Nous sommes forcément plus efficaces, plus brillants à plusieurs. Un problème se résout lorsque toutes les parties prenantes sont autour de la table avec comme objectif commun d’apporter une connaissance dans le sens d’une résolution (et dans le respect d’une communication non violente).
La concertation. Plus elle arrive en amont, plus elle a des chances de réussir. La concertation « pompier » est vouée à l’échec. Il faut veiller à ne pas tomber dans ses effets pervers, c’est-à-dire à aboutir dans l’oubli des objectifs.
Le savoir de l’expert. L’expert est un scientifique qui est amené à mobiliser des connaissances scientifiques. Attention : le scientifique n’est pas le naturaliste, et inversement. Les deux se complètent mais on ne peut se fier strictement à une expertise naturaliste : c’est ce qui pose un problème car cela représente la majorité des cas d’expertise.
Cependant, les seuls savoirs à disposition de l’expert ne suffisent pas à la résolution d’un conflit environnemental. Il faut ouvrir les esprits sur une interdisciplinarité et un partage des connaissances.
D’autres problèmes se posent : l’expertise est méticuleusement tenue à l’écart des prises décisionnelles. Encore énormément de progrès sont demandés afin d’intégrer l’avis des experts.
Enfin, les experts sont bien souvent sollicités pour répondre à une question mais n’ont pas la liberté de la remettre en question. Le choix devient alors : l’auto-éjection ou bien la caution. On est alors dans une contre résolution de conflit environnemental.
Le rôle du progrès. Il n’est pas seulement technologique. Il faut promouvoir un progrès intellectuel, et aussi un progrès spirituel.
Les ordres de mission. En matière d’expertise judiciaire, le développement est devenu une véritable mission. Il existe maintenant des Ordre de mission : le juge demande une solution de médiation et des experts en médiation doivent alors intervenir.
L’application du droit. Nous sommes dans un état de droit en France, et l’intervention par le peuple demeure fondamentale. Dans beaucoup de dossiers, le droit n’est pas correctement appliqué.
Les lacunes de notre système. On retiendra principalement le manque de responsabilisation juridique et pénale ainsi que le manque d’inventivité des décideurs.
Un paradoxe comme limite. Nous sommes des êtres qui aspirent à des choses contradictoires : nous vivons dans un paradoxe. Nous voulons tous les avantages, sans les inconvénients. Le matérialisme historique est inscrit dans nos territoires, ce sont les choix d’hier qui entraînent des conséquences sur les structurations de nos sociétés d’aujourd’hui. Il y a des contradictions entre les injonctions et les structurations.
Les conflits à venir. L’accès aux ressources, la pollution atmosphérique et l’Energie s’imposent comme les conflits majeurs d’aujourd’hui et de demain. La santé et l’indépendance sont sévèrement mises à mal.
Le mot de la fin
Il faut être désespérément optimiste. L’éducation et l’anticipation sont les deux outils à retenir.